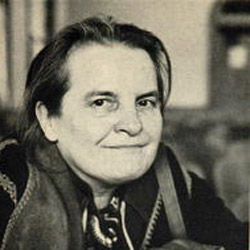
16 Jan Anscombe et l’intention
Journée d’étude organisée par Claude Gautier (ENS de Lyon/TRIANGLE)
et Stéphane Madelrieux (Lyon 3 /IRPHIL et IUF)
Jeudi 16 janvier 2014
- 10h. Valérie Aucouturier (VUB – Brussels Free University)
« L’expression des intentions »
Dans Intention, Elizabeth Anscombe commence par distinguer trois usages de la notion d’intention : (1) l’expression d’intention (pour le futur), (2) le fait de dire d’une action qu’elle est intentionnelle, et (3) l’intention dans laquelle on agit. Néanmoins, elle ne consacre proportionnellement que très peu de sections au premier usage, l’expression d’intention, qui aurait, à première vue, pu sembler le lieu privilégié de son enquête. En réalité, elle finira par affirmer au §50 que « ce qu[‘elle] a dit de l’intention dans l’action s’applique aussi à l’intention dans une action projetée » (le premier usage). L’objet de mon intervention sera d’examiner les raisons qui permettent à Anscombe d’opérer cette transposition et de faire l’économie d’un examen plus conséquent de l’expression d’intention.
- 11h. Cyrille Michon (Université de Nantes) « L’intention en termes de langage »
Au § 47, Anscombe dit qu’elle a défini l’action intentionnelle « en termes de langage », parce qu’elle a fait émerger ce qui caractérise l’action intentionnelle au moyen de l’application (ou de l’applicabilité) de la question « Pourquoi ? ». Mais cette formule s’applique également à d’autres aspects de son analyse (l’expression d’intention, le rapprochement de l’intention et de l’ordre, l’intention sous une description), et notamment l’idée de « forme de description des actions intentionnelles » (§§46 et 47). Je commenterai l’importance accordée à cette forme de description pour élucider le concept d’intention.
12h-14h : pause
- 14h. Rémi Clot-Goudard (Université de Grenoble)
« Intention, motif, cause mentale »
Afin d’éclaircir le sens approprié de la question « Pourquoi ? » dont l’applicabilité circonscrit le domaine des actions intentionnelles, Anscombe est amenée à introduire, dans les §§10-15, la notion de « cause mentale » qu’elle oppose aux intentions et, plus généralement, aux motifs. Je me propose de revenir sur ces distinctions et leur importance dans l’analyse.
- 15h. Bruno Gnassounou (Université de Nantes)
« Action et connaissance sans observation »
Les actions intentionnelles sont connues sans observation, dit Anscombe (§ 8). Je me propose d’expliquer cette notion de connaissance sans observation et de montrer en quoi elle éclaire la notion de connaissance pratique qu’Anscombe veut réhabiliter, « connaissance qui s’exerce dans l’action ». (§ 48).
16h-16h15 : pause
- 16h15. Vincent Descombes (EHESS)
« Logique et psychologie du raisonnement pratique »
Partant de la remarque selon laquelle « Je veux » ne doit pas figurer dans la première prémisse d’une inférence pratique (§35), je commenterai les pages concernant la connexion entre les concepts du vouloir et du bon (§37, §40).
Entrée libre et ouverte à toutes et à tous dans la limite des places disponibles
Lieu
Salle 314
Université Jean Moulin – Lyon 3
18 rue Chevreul
69007 Lyon
